Contrôle entier du juge administratif sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics
Par un récent arrêt du 13 novembre 2013, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Lebon (CE, Sect., 9 juin 1978 : Rec. CE, p. 245), selon laquelle le juge administratif exerçait un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’adéquation entre, d’une part, la sanction infligée à l’agent public et, d’autre part, la faute commise par ce dernier. En effet, pour que le juge administratif prononce l’annulation de la sanction sur le fondement de ce contrôle, il appartenait jusqu’alors au requérant de démontrer qu’il existait une disproportion manifeste entre la sanction appliquée et les manquements reprochés par sa hiérarchie.
Désormais, selon la Haute assemblée, « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » (CE, 13 novembre 2013, M. B. : req. n°347704). En l’espèce, il a été jugé que la sanction de mise à la retraite d’office infligée M. B., ambassadeur, n’était pas disproportionnée.
Suivant les conclusions de son rapporteur public, les juges du Palais Royal ont ainsi adopté une jurisprudence plus conforme aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose le respect du droit à un procès équitable pour le contentieux applicable aux agents publics (CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen : AJDA 2007, p. 1360). Ce revirement, qui était attendu, permet également de poursuivre l’évolution ayant amené le juge à exercer un contrôle entier sur les sanctions infligées aux professionnels (CE Sect., 22 juin 2007, Arfi : req. n°272650).
Conseil d'État N° 347704 ECLI:FR:CEASS:2013:347704.20131113
La méthode de notation du critère prix dans un marché public
Le Conseil d’État est venu confirmer les conditions de notation du critère prix dans un marché public.
Ce critère, fondamental, et souvent utilisé par les acheteurs publics (sans le retenir comme seul critère, sauf exception : CE 6 avril 2007 Département de l’Isère, req. n° 29884), est contrôlé en jurisprudence comme suit :
- La note maximale doit être attribuée au moins disant. Cette pratique, qui n’est pas toujours opérée, doit désormais être respectée.
- L’offre de prix la plus éloignée de l'estimation du coût de la prestation par le pouvoir adjudicateur ou son maître d’œuvre reçoit la
note la plus faible.
Par ces précisions, le Conseil d’État indique de manière didactique comment ne pas subir une contestation de la notation du critère prix, moyen que l’on rencontre de plus en plus fréquemment dans les procédures de référé précontractuel notamment.
CE 29 octobre 2013 Val d’Oise Habitat, req. n° 370789
L'ouverture du Conseil d'Etat sur le « mieux-disant social »
Saisi par le département de l'Isère d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d'Etat a assoupli son appréciation du lien entre le critère social et l'objet du marché. Il a ainsi jugé, de manière inédite, « que dans le cadre d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres ».
Cet arrêt paraît mettre un terme à une jurisprudence restrictive, aux termes de laquelle l'insertion d'un critère social par les pouvoirs adjudicateurs était quasiment toujours sanctionnée par l'annulation de la procédure de mise en concurrence. En effet, la prise en compte d'aspects sociaux dans le cadre de la passation des marchés publics était, de fait, rendue presque impossible par la jurisprudence, hormis par le recours à des conditions sociales d'exécution du marché. Or, une telle jurisprudence dénotait non seulement une résistance au droit de l'Union européenne, mais se révélait également peu respectueuse de la volonté du législateur. L'incompréhension des élus locaux était d'autant plus profonde que de nombreux types de marchés publics, notamment en matière de travaux, permettent le recours à une main-d'œuvre peu voire non qualifiée.
Par son arrêt du 25 mars 2013, le Conseil d'Etat a finalement ouvert aux pouvoirs adjudicateurs la possibilité de recourir effectivement, et indépendamment du recours à des clauses sociales d'exécution, au «mieux-disant social». Pour faire usage de ce nouvel instrument, la pondération retenue paraît devoir être modérée et les conditions de mise en œuvre suffisamment détaillées par le règlement de la consultation. Il s'agit d'un assouplissement bienvenu qui, à n'en point douter, sera accueilli avec satisfaction par les acheteurs publics.
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25/03/2013, 364950, Publié au recueil Lebon
Redéfinition de la voie de fait
Saisi par la Cour de cassation d'un litige opposant Electricité réseau distribution de France (ERDF) au propriétaire d'un terrain sur lequel un poteau électrique avait été implanté sans titre, le Tribunal des conflits procède à une redéfinition de la voie de fait.
Dans son arrêt du 17 juin 2013, celui-ci énonce en effet «qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative» (TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ Sté ERDF Annecy Léman : req. n°3911 ; AJDA 2013, p. 1245).
La juridiction paritaire ajoute «que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration». En l'absence de voie de fait, le litige ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative.
La voie de fait, consistant jusqu'alors en «une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale» (V., par exemple : TC, 23 mai 2005, Haut-commissaire de la République en Polynésie française : req. n°3452, AJDA 2005, p. 1151) est ainsi redéfinie : il n'y a plus désormais voie de fait, justifiant la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'en présence d'une «atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété».
Renvoyant aux fonctions traditionnelles du juge judiciaire, cet arrêt délimite de manière plus stricte la compétence de ce dernier, tandis que le juge administratif statuant en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) est chargé de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Récemment, ce dernier s'était même reconnu compétent pour statuer alors qu'une voie de fait était constituée (CE ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui : req. n°365262 ; AJDA 2013, p. 788).
Tribunal des Conflits, , 17/06/2013, C3911, Publié au recueil Lebon
L'actualité en droit immobilier avec le Cabinet d'Avocats Mollion
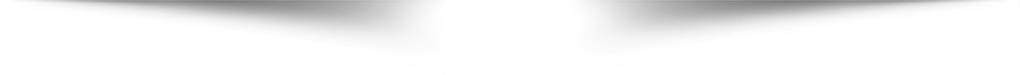


GRENOBLE - CHAMBERY

Cabinet Grégory MOLLION
5, rue Félix Poulat
38000 Grenoble
une réalisation Site Internet 38